Par Samir Ben Salem, psychanalyste.
Étymologie de la confrontation
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) le terme confrontation vient du latin médiéval confrontatio dont le sens attesté en 1080 signifie la « partie limitrophe de deux propriétés ». Au 13e siècle il prendra le sens de « collationnement de deux choses en vue d’une comparaison ». Dans la perspective de cette étymologie, la confrontation à soi suppose deux choses, deux éléments distincts à comparer. Or ici nous parlons de « soi » donc, a priori, d’un seul élément. Dès lors où peut se jouer la confrontation lorsqu’on semble évoquer l’unité ?
Raisonnons par l’absurde et allons pleinement dans l’hypothèse inverse. Supposons qu’il n’y a pas de confrontation à soi possible dans l’idée qu’il n’y a que soi et rien d’autre que soi. En toute logique cela équivaudrait à émettre la déduction suivante, à savoir : que nous avons un rapport direct à nous-mêmes, en toute vérité, partout, tout le temps. Que nous sommes dotés d’une omniconscience de soi, sans incompréhension, sans inconscience, sans filtre, sans parasitage, ni détours, biais perceptif ou excuses. En bref, sans illusions.
Ça fait beaucoup ! Comme on le voit, récuser la possibilité d’une confrontation à soi ne peut faire l’économie de produire une hypothèse inverse très lourde que l’honnêteté intellectuelle ne peut admettre. Celle d’un accès direct au réel de soi.
Soi et les illusions sur soi
Comme vous l’aurez compris, il y a donc soi et les illusions sur soi. Deux éléments qui nous permettent de parler de confrontation à soi.
Se confronter à soi c’est ainsi se confronter au réel puisqu’il est question d’outrepasser nos illusions. Dès lors il est important de faire un détour plus global sur le rapport que l’on peut avoir au réel en tant qu’être humain avant d’entrer dans la thérapeutique elle-même. Puisqu’on ne peut entrer véritablement en contact avec soi qu’avec l’altérité que présente le monde. Qu’est-ce que le réel ? Comment peut-on y accéder pour revenir à soi et se saisir dans le plus de vérité possible ? D’autant plus que la difficulté d’accéder au réel est un thème qui parcourt la totalité des savoirs puisque ce réel nous n’y avons jamais accès directement. Peu importe l’objet de ladite connaissance. Une allégorie aussi pédagogique qu’acquise à la postérité est très illustrative à ce propos.
Dans l’allégorie de la caverne, Platon enseigne, par le procédé littéraire, la difficulté qu’il y a d’accéder à ce qui est au-delà de ce que les sens peuvent nous présenter à priori. Ce qui nous plonge dans l’illusion sur le monde et donc sur soi.
Sortir des aliénations : entre fuite et courage, entre rupture et persévérance
Des hommes sont emprisonnés dans une caverne depuis leur enfance « les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l’avant ». La seule chose qui leur parvient de l’extérieur sont les ombres projetées sur la paroi de la grotte par un feu qui est allumé derrière eux. Entre eux et ce feu, des marionnettistes, cachés derrière un mur, agitent des objets fabriqués pour que l’ombre de ces derniers se projette sur le fond de la caverne. La description étant un peu lourde pour la visualisation voici une image qui représente la caverne :

Ces prisonniers symbolisent la condition de l’être humain. À savoir que nous commençons notre existence par une naïveté au monde qui nous abuse quant à la réalité des choses. Par leurs sens, les prisonniers ne voient que des ombres agitées. Autrement dit des « traces insaisissables » d’objets qu’ils n’ont jamais vues directement. Ils prennent ces ombres pour des objets en soi. Ils vivent dans l’illusion. Ils n’ont connu que ça. Ainsi « […] de tels hommes considéreraient que le vrai n’est absolument rien d’autre que l’ensemble des ombres des objets fabriqués ».
Platon assimile explicitement cette condition à un trouble, une maladie. « Examine alors, dis-je, ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement ». Le disciple de Socrate précise que cette guérison n’ira pas sans douleur. Quitter ses illusions provoque, dans un premier temps, de la souffrance, de l’affliction, du déchirement. « Chaque fois que l’un d’eux serait détaché, et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher, et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes il souffrirait, et l’éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont tout à l’heure il voyait les ombres […] Ne crois-tu pas qu’il serait perdu, et qu’il considérerait que ce qu’il voyait tout à l’heure était plus vrai que ce qu’on lui montre à présent ? »

Le déchirement que cette nouvelle naissance provoque met en évidence qu’on ne peut passer de l’illusion à la réalité d’un coup d’un seul, sans accommodation progressive. Pour passer de l’obscurité de la caverne symbole de l’illusion (le « monde sensible » chez Platon), au monde extérieur et à la vision directe de la lumière du soleil, symbole de la vérité (le « monde intelligible ») il faut des médiations. Des étapes que Platon décrit de la sorte :
« Pour commencer, ce seraient les ombres qu’il distinguerait plus facilement, et après cela, sur les eaux, les images des hommes et celles des autres réalités qui s’y reflètent, et plus tard encore ces réalités elles-mêmes. À la suite de quoi il serait capable de contempler plus facilement, de nuit, les objets qui sont dans le ciel, et le ciel lui-même, en tournant les yeux vers la lumière des astres et de la lune, que de regarder, de jour, le soleil et la lumière du soleil. » […] Alors je crois que c’est seulement pour finir qu’il se montrerait capable de distinguer le soleil, non pas ses apparitions sur les eaux ou en un lieu qui n’est pas le sien, mais lui-même en lui-même, dans la région qui lui est propre, et de le contempler tel qu’il est. »
Après avoir contemplé le soleil, le prisonnier a été transformé. La confrontation qu’il a eu l’audace d’assumer l’a libéré. Il ne s’arrête plus naïvement aux apparences, il est devenu philosophe au sens platonicien du terme. Ce statut l’investit désormais d’une charge : il va devoir retourner dans la caverne pour aider ses anciens compagnons toujours enchaînés dans l’obscurité à gagner le vrai monde. Seulement notre ancien prisonnier s’est habitué au vrai monde, au monde intelligible pour reprendre la terminologie platonicienne. Il n’est plus accoutumé au monde des illusions. Retourner dans la caverne va lui poser des difficultés. Il sera moins performant dans l’obscurité que ses anciens compagnons qui ne l’ont jamais quitté. Cette perte d’habitude va le rendre risible à leurs yeux et cela entamera même sa crédibilité. Il paraîtra venir du monde d’en haut avec une perte de capacité, ses yeux n’arrivant même plus à bien percevoir les ombres agitées dans l’obscurité de la caverne.
« Alors s’il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces hommes-là qui n’ont pas cessé d’être prisonniers, au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis, et alors que le temps nécessaire pour l’accoutumance serait loin d’être négligeable, ne prêterait-il pas à rire, et ne ferait-il pas dire de lui : pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés ? Et : ce n’est même pas la peine d’essayer d’aller là-haut ? ».
Le prisonnier revenu en philosophe risquerait même d’être tué par ces anciens compagnons étant perçu comme un perturbateur qui ébranle les opinons qui fondent la réalité de la caverne.
« Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en haut, s’ils pouvaient d’une façon ou d’une autre s’emparer de lui et le tuer, ne le tueraient-ils pas ? Ici, Platon fait référence à son maître Socrate qui a été condamné à mort par le tribunal de l’Héliée alors qu’il incitait ses concitoyens à l’interrogation des connaissances par sa fameuse méthode, la maïeutique, « l’art d’accoucher les esprits ». Pour le condamner à mort, le tribunal l’a accusé de corruption de la jeunesse et d’offense aux divinités selon Platon.
Le sentiment d’effondrement

Toute la situation décrite dans l’allégorie illustre bien le fait que s’attaquer aux illusions n’est pas une affaire anodine. Il ne s’agit pas de mettre des coups d’épée dans l’image vaporeuse d’un mirage pour s’apercevoir qu’elle n’a aucune substance propre.
Percer ses illusions c’est voir un monde qu’on avait pris pour LE monde s’effondrer. C’est voir le « sol mythique » sur lequel on marchait se dérober pour reprendre l’expression de Raphaël Liogier. C’est un processus intrinsèquement violent. C’est pourquoi envisager une thérapie efficace sans secousse est illusoire, sans mauvais jeu de mots. Les épreuves sont inévitables dans la connaissance de soi. D’où la nécessité d’étapes. Même si ces dernières ne peuvent éliminer complètement la violence ressentie, elles permettent néanmoins de rendre cette violence, la plus supportable possible, pour finir par s’en défaire complètement. Si la tâche est ingrate sur le moment, elle est incroyablement libératrice sur le temps. C’est une douleur d’accouchement de soi qui est la conséquence de son agrandissement intérieur. S’il ne faut pas la sous-estimer, il faut savoir qu’elle est transitoire et qu’elle n’est rien par rapport aux fruits inestimables qu’elle produit.
Mais on ne s’expose pas au réel abruptement. C’est un principe de notre ontologie humaine. Cette compréhension permet de souligner une fonction non seulement indispensable, mais positive à l’illusion. Elle agit en tant que fiction médiatrice du réel. Elle est l’espace, la récréation, la mise en attente qui nous permet de devenir plus grand que ce que l’on était hier en temporisant à l’instant T ce qu’on est capable de supporter relativement aux ressources dont on dispose au temps présent. L’illusion atteste que nous sommes des êtres en devenir. Des êtres qui ont la capacité de progresser. Lorsqu’on se confronte au réel on s’aperçoit que des certitudes qu’on n’a vainement acquises se révèlent êtres des illusions. Que nous avons pu agir et prendre des décisions lourdes de sens à partir de considérations qui se révèlent être construites sur du sable.
Comment ne pas trembler ? Des édifices que l’on a mis des années à construire s’effondrent car leur fondation était imaginaire. Mais ce pas vers la connaissance, courageux, incorruptible, qui vaut bien plus que tous les effondrements, nous rapproche un peu plus du réel et nous libère d’une façon qu’on n’aurait même pas osé imaginer une fois ce degré de réel supérieur intégré. La confrontation est aussi difficile que salvatrice. L’important étant qu’elle reste dans un cadre qui respecte les ressources dont on dispose sur le moment.
Le réel est voilé
Seulement il ne faut pas être naïf sur ce qu’on appelle le réel d’autant plus que le réel lui-même ne s’expose pas à nous directement. Ce dernier ne laisse jamais voir son essence. Pour reprendre des concepts philosophiques platoniciens, nous pouvons dire que nous avons accès aux phénomènes c’est-à-dire à la manifestation des choses, mais jamais aux noumènes c’est-à-dire à la nature des choses en soi. Ce que perçoivent nos sens (les phénomènes), quel que soit l’objet de la perception, est déjà filtré, interprété, partiel avant même que nous pussions faire quoi que ce soit par notre volonté. Et notre volonté elle-même va être conditionnée par une série d’éléments culturels, intellectuels, émotionnels qui, en même temps qu’ils nous révèlent le monde, nous le filtrent par une lecture particulière et donc jamais absolue. Le noumène, la réalité des choses en elle-même, nous reste voilé. C’est pourquoi on peut décrire un même objet sans que l’on puisse épuiser sa description. Parce que chaque découverte, chaque nouvelle lecture nous ouvre d’autres questions et change même totalement la nature de la définition de l’objet en question en fonction des connaissances nouvellement acquises.
Kant reprendra cette distinction platonicienne dans son œuvre critique de la raison pure au chapitre 1 (L’esthétique transcendantale) en leur donnant une réorientation particulière notamment par le fait qu’il va délimiter le terrain du savoir. En effet, Kant ruinera les prétentions de la raison à connaître la réalité ultime des choses, particulièrement dans le chapitre 2 (l’antinomie de la raison pure). Dans ce passage aussi génial qu’il a fait date dans l’histoire de la philosophie avec un avant et un après, Kant cite quatre antinomies qui démontrent que la raison ne peut-être au fondement de la raison sans causer de contradiction logique. La 1ère antinomie est que je peux dire que le monde a un commencement mais je peux aussi dire que le monde a toujours existé. Chacune de ces affirmations ne peuvent etre dites sans penser à l’autre qui est son antinomie. Elles sont fondamentalement contradictoires et la raison ne peut les départager. La raison a besoin de métaphysique, littéralement ce qui est au-delà de la physique. Autrement dit, la raison a besoin de postuler quelque chose au-delà de l’espace et du temps pour sauver les principes de la logique car ses derniers ne peuvent se soutenir eux-mêmes d’un point de vue des fondements théoriques. Ils ne peuvent être sauvés que par quelque chose qui les dépasse mais que la raison ne peut connaître car par définition c’est au-delà de l’espace et du temps. Ce postulat suprasensible transcende la causalité telle qu’on peut scientifiquement la connaître.
Cette conception kantienne sera au fondement de nos sociétés modernes. La subjectivité transcendantale. Personne ne peut m’imposer un dogme, une croyance parce que si la foi est rationnelle chez Kant et que la raison en a besoin, elle ne peut être un objet de savoir au sens scientifique du terme. Kant distingue le savoir, la connaissance, au sens scientifique, de la pensée qui est la possibilité de spéculer sans que la raison ne puisse en apporter de réponse. La raison peut se poser la question de Dieu, mais elle ne peut le connaître en un sens scientifique. Ainsi, ma subjectivité sur la question ne peut donc s’imposer à un autre d’un point de vue rationnel, puisque la rationalité à des bornes dans sa capacité à connaître. Toute la philosophie des sociétés occidentales est basée sur ce principe.
La raison est limitée par la raison elle-même, elle ne peut tout connaître et il me semble que c’est un principe très important à garder en tête dans la connaissance de soi car il montre à quel point il est difficile de réfléchir en soi. L’accès au réel est toujours partiel et médiatisé par un processus intellectuel qui peut être entaché d’un nombre phénoménales d’erreurs d’interprétation. Ainsi lorsqu’il s’agit de réfléchir à soi, c’est encore plus délicat. Cela demande de la combativité, encore plus quand notre psyché nous protège de nous-mêmes.
L’odyssée du travail sur soi : de l’inconscience à la conscience
Les divers courants des sciences psychologiques décrivent tous des mécanismes inhérents à notre structure qui vont nous protéger de la réalité ; le déni, la dénégation, le refoulement, le pare-excitation, la dissociation, la projection, la dissonance cognitive, etc. Autant de mises à distance qui nous permettent de temporiser la survenue d’une réalité brisant nos fictions jusqu’à ce qu’on se consolide suffisamment au niveau psychique pour finir par intégrer un niveau de réel plus profond que précédemment. D’ailleurs toute la science psychologique n’est-elle pas fondée sur ce principe ontologique que le réel nous est d’abord voilé avec cette notion fondatrice d’inconscient ?
On a vu que le réel nous posait problème et pas seulement par mauvaise foi ou dédain à son égard. Nous sommes, dans notre nature même, bâtis pour ce que réel soit, dans un premier temps, voilé. Ce réel lui-même ne se donne pas à voir comme ça. Dans le cadre spécifique du travail intérieur, on peut se demander pourquoi sommes-nous voilés à nous-mêmes au point de nous plonger dans le déni ? Pourquoi a-t-on autant besoin de fictions médiatrices du réel dans la constitution de notre identité au-delà de ce qu’on a exposé jusqu’à maintenant ?
Au début de l’article, nous disions que la confrontation à soi supposait deux éléments. À nous même, s’ajoutait un second ; les illusions sur nous-mêmes. Si elles sont là, et on ne peut que le constater, on peut se demander, au niveau psychique, d’où proviennent-elles ? Pourquoi ne sommes-nous pas des êtres dans la vérité d’eux-mêmes naturellement ?
Psychiquement parlant nous sommes un, mais ce un est compartimenté. Et ici l’approche jungienne est très éclairante. Mais avant d’aborder la question précisons une chose à propos de l’approche dîtes jungien ou plutôt laissons C. G. Jung le préciser lui-même :
« … Je ne puis qu’espérer et souhaiter que personne ne sera « jungien ». Je ne défends pas une doctrine, mais décrits des faits et propose certaines affirmations que je tiens pour susceptibles d’être discutées. Je n’annonce pas d’enseignement tout prêt et systématique et j’ai horreur des suiveurs aveugles. Je laisse à chacun la liberté de venir à bout des faits à sa manière, car je revendique également pour moi cette liberté.»
La partie consciente, le moi conscient dans l’approche jungienne, est à la périphérie de nous-même. Dans la première partie de notre vie, notre centre de gravité, la conscience, le Moi, se situe à la périphérie de notre totalité psychique et non pas au centre. Le centre, Jung l’appelle le Soi. Pour parler simplement, notre partie consciente n’est, dans un premier temps que la surface de nous-mêmes. Et cette partie consciente s’identifie d’abord et en quelque sorte exclusivement à la persona, surface qui va par symétrie produire une contre personnalité dans la profondeur de la psychée ; l’ombre, qui elle se trouve dans l’inconscient.
Persona est un mot latin qui désigne à l’origine le masque porté par les acteurs au théâtre à l’époque dans l’antiquité. Dans la perspective jungienne la persona c’est le masque social. C’est ce qu’on donne à voir aux autres, et c’est aussi ce que l’on croit être : le statut social, les diplômes, le métier qu’on exerce, le couple qu’on forme, etc. C’est une identification issue d’un contrat social entre l’individu et la société. Un compromis. La représentation de nous-mêmes qui répond aux conventions que le corps social a mise en place et par laquelle on tire reconnaissance et donc existence en tant qu’individu.
Or, si tout ceci n’est pas mauvais en soi, toute vie en société nécessitant une adaptation à cette même société, cela reste tout de même périphérique à notre être. Des millions de gens partagent un même diplôme, un même métier, une même situation sociale, à l’inverse de notre monde intérieur qui lui est unique dans son rapport au monde. Notre véritable être n’est pas réductible au Moi conscient. Pour déplacer le centre de gravité du Moi (la périphérie) au Soi (la centralité) il faut s’unifier. C’est le « processus d’individuation ».
Ce processus d’individuation vise à nous faire entrer en contact avec des instances psychiques qui sont en nous, mais séparées de notre partie consciente. Étant psychiquement compartimentées ces instances ont leurs autonomies et énergies propres. Leur libido qu’il va falloir intégrer.
Chez Jung le concept de libido a un sens beaucoup plus large que dans la conception freudienne. Il s’agit de l’énergie psychique au sens large. Jung s’inspire du concept d’élan vital du philosophe français Henri Bergson que ce dernier développe dans son ouvrage « L’évolution créatrice ». On peut également faire un parallèle avec le concept de conatus – le fait de faire l’effort de préserver dans son être – qu’on retrouve chez le philosophe néerlandais Baruch Spinoza dans son œuvre illustre « L’Ethique ».
Cette intégration de l’énergie psychique non conscientisée est pour le moins rock n’roll. Mais c’est une nécessité. Elles sont intrinsèquement en nous. Ces énergies psychiques ne sont pas déterminées par le passé, elles sont supérieures aux contingences. Elles sont la nécessité de devenir plus grand que ce que l’on est. Ce qui fera dire au poète grec Pindare, 5e siècle avant J.-C : « Deviens ce que tu es, quand tu l’auras appris », que Nietzsche reprendra dans « Ainsi parlait Zarathoustra » où il incite l’homme à s’arracher de sa médiocrité « Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire ». Elles sont la possibilité de dépasser les contingences auxquels nous faisons face.
Les assumer est ce qui fait toute la dignité de l’être humain. À l’inverse elles en font sa chute. Ou bien nous intégrons ces dynamiques psychiques intérieures et nous nous individuons. Nous devenons alors bien plus larges que ce qu’ont fait de nous les conventions sociales. Ou bien ces instances psychiques sont récusées et en conséquence elles s’autonomisent encore plus de notre partie consciente. Elles finissent par nous fragmenter, prendre possession de nous-mêmes et nous écraser depuis l’inconscient, car leurs dynamiques n’ont pas été intégré à la sphère consciente.
« L’individuation n’a d’autre but que de libérer le Soi, d’une part des fausses enveloppes de la persona, et d’autre part de la force suggestive des images inconscientes ». Jung.
Pour être plus clairs que les concepts psy qui peuvent vite devenir abstraits nous pouvons convoquer un autre philosophe.
Dans les considérations Considérations inactuelles III et IV Frederich Nietzsche écrivait avec le style qu’on lui connaît :
«[…] les hommes sont encore plus paresseux que timorés et ils craignent avant tout les ennuis dont les accableraient une honnêteté et une nudité absolues. […] Si le grand penseur méprise les hommes, c’est leur paresse qu’il méprise, car c’est elle qui leur donne l’allure indifférente des marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d’enseignement. L’homme qui ne veut pas appartenir à la masse n’a qu’à cesser d’être indulgent à son propre égard ; qu’il suive sa conscience qui lui crie : “Sois toi-même ! Tu n’es pas tout ce que maintenant tu fais, penses et désires”. Toute âme jeune entend cet appel jour et nuit, et tressaille : car elle pressent la mesure de bonheur qui lui est destinée de toute éternité quand elle pense à sa véritable émancipation : bonheur auquel d’aucune manière elle ne parviendra aussi longtemps qu’elle restera dans les chaînes de l’opinion courante et de la peur. Et quelle vie sans espoir et dépourvue de sens peut s’ouvrir sans cette libération ! Il n’existe pas dans la nature de créature plus sinistre et plus répugnante que l’homme qui s’est dérobé à son propre génie et qui louche maintenant à droite et à gauche, en arrière et de tous les côtés. On n’a même plus le droit à la fin d’attaquer un tel homme, car il n’est qu’extérieur sans noyau, vêtement bouffant, teint et usé, fantôme chamarré qui ne peut inspirer la peur et moins encore la compassion »
Dans cette quête intérieure pour parvenir à la centralité du Soi, la première rencontre, très critique, mais aussi très libératrice, est la rencontre avec ce que Jung nomme l’Ombre.
« De deux choses l’une, nous connaissons notre ombre ou ne la connaissons pas ; dans ce dernier cas, il arrive souvent que nous ayons un ennemi personnel sur lequel nous projetons notre Ombre dont nous le chargeons gratuitement, et qui à nos yeux, la porte comme si elle était sienne, et auquel en incombe l’entière responsabilité ; c’est notre bête noire, que nous vilipendons et à laquelle nous reprochons tous les défauts, toutes les noirceurs et tous les vices qui nous appartiennent en propre ! Nous devrions endosser une bonne part des reproches dont nous accablons autrui ! Au lieu de cela, nous agissons comme s’il nous était possible, ainsi, de nous libérer de notre Ombre ; c’est l’éternelle histoire de la paille et de la poutre. »
Avec l’image de la paille et de la poutre, Jung fait référence à un passage de la Bible que l’on retrouve par exemple au chapitre 7 de l’évangile de Mathieu, verset 3 à 5
« Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère. »
La morale de cette métaphore hyperbolique est aussi limpide que lapidaire ; avant de juger les autres, il faut être juge de soi sinon on risque de vêtir l’autre de ses propres turpitudes en devenant ainsi aveugle aux siennes. Attitude qui, socialement, est très délétère.
Intégrer l’ombre c’est se rendre compte que tous les travers qu’on peut constater chez un individu, sont également constatables chez soi car nous partageons la même potentialité humaine. En bien comme en mal. Savoir intellectuellement banal mais expérimentalement traumatisant. Ce qui fera dire à Terence de Carthage « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger, je crois ».
En tout état de cause cette potentialité, du bien comme du mal est en chacun de nous et toujours là. Mais l’ombre, ça n’est pas que les mauvaises potentialités au sens du mal. Ce sont aussi les potentialités abrégées, non reconnues, récusées, voire même combattues.
Les potentialités de l’ombre
Des trésors. Les trésors de notre personnalité qui n’ont jamais été reconnus dans notre éducation et, si cela se prolonge, dans notre vie sociale. Par exemple, si on a un goût prononcé pour les sciences sociales dans une famille de scientifiques qui méprisent les sciences sociales. L’individu, dans ce contexte, va être coupé de lui-même parce que ses parents ou plus largement ses tuteurs passeront à côté de toute une part de sa personnalité en projetant sur lui des orientations qui ne lui correspondent pas. Avec toutes les perturbations que cela pourra causer. Voilà un exemple d’énergie psychique, de libido, contrariée. Il est simple d’imaginer ainsi la libération que va provoquer une rencontre chez cet individu qui va lui reconnaître ce goût et ce talent. Il pourra avoir l’impression de revivre, d’être lui-même et d’ainsi libérer une énergie qui jusqu’à lors lui causait du tort car elle était enfermée et non reconnue. Or, comme on l’a dit, cette libido-là est autonome par rapport au conscient, elle continuera de s’exprimer même récusée. Et de plus en plus fortement tant qu’elle ne sera pas reconnue. Jusqu’à causer des dépressions et plus généralement un mal-être. Tout est dans dit dans l’expression « mal-être » d’ailleurs. S’individuer ne relève pas donc d’une option, mais bien d’une nécessité humaine. Sinon on dépérit, lorsqu’on garde ses affres pour soi. Ou on devient une cause de perturbation des autres en se fuyant soi-même pour investir, de façon intrusive, la vie des autres. La prise d’otage psychique dont raffole le pervers.
Ici les prises de conscience sont à la fois salvatrices, libératrices, la personne se rend compte de ses goûts et de ses talents, mais elles peuvent être amères. Amères car elles montreront à quel point ses parents, son entourage, ses professeurs, etc. n’ont pas su le reconnaître dans ce qu’il était. Et à quel point elle a pu être à coté de ses pompes comme le métaphorise si bien l’expression populaire. Et cela soulèvera indubitablement des questions sur soi et les autres, tout ceci accompagné d’une reconfiguration des relations sociales. Et là encore, envisager tout ceci intellectuellement est simple mais en faire l’expérience est traumatisant.
C’est pourquoi aller profondément en soi c’est inexorablement développer un esprit critique, un regard de plus en plus acerbe sur certaines conventions sociales, sur une certaine façon d’éduquer, sur une certaine façon d’être au monde. La libération produit de la mise à distance, du recul et un comportement qui nous sort d’une servitude aveugle par rapport à tout ce que la société propose comme comportement.
Chaque prise de conscience sur soi est une prise de conscience sur son environnement proche et sur le monde. Ça n’est pas simple.
C’est pourquoi l’intégration de l’ombre est critique, déstabilisante. Rencontrer sa contre-personnalité, donc par définition celui ou celle qu’on a refusé d’être et/ou qu’on nous a refusé d’être relève de l’ordre du combat. C’est de l’ordre de la confrontation pour revenir au mot qui a inauguré cet article. Mais lorsqu’on est capable de dialoguer avec sa contre-personnalité on est libéré de l’amertume, de la culpabilité, de la honte, de tout ce qui a été déposé en son sein et jugé comme indigne ou de peu de valeurs par sa conscience et la socialité extérieure. On s’unifie et on poursuit le travail d’individuation avec une énergie qui n’a jamais été aussi intense dans notre vie. Lorsqu’on a su s’affronter et mourir en soi, alors on peut tout affronter. Il faut mourir en soi avant de mourir tout court pour être pleinement vivant.
Il y a d’autres instances psychiques, mais le principe est toujours le même. S’unifier en combattant les illusions sur soi, les faux-semblants, le déni, mais étape par étape. Cette volonté de ne pas brûler les étapes et de respecter son tempo psychique est extrêmement importante. C’est un pilier de la thérapeutique.
C’est cette volonté d’être qui nous structure et nous dévoile notre propre génie pour paraphraser Nietzsche. À l’inverse on dépérit dans un décor de faux semblant… S’unifier, travailler sur soi, c’est devenir qui l’on est vraiment. Pour éviter de ressembler à ces « marchandises fabriquées en série, indignes de commerce et d’enseignement. »
Pour découvrir et rencontrer le Sens à commencer par le sens de soi-même, l’être humain doit faire tout un travail sur lui. Il doit dépasser les réalités trompeuses de ce monde que Platon symbolise par la caverne, en faisant tout un voyage intérieur. Voyage qui requiert de la combativité, de l’exigence vis-à-vis de soi-même tout en respectant une progressivité. Attention à ne pas brûler son identité dans un saut trop précipité dans le réel.
La confrontation à soi est la meilleure protection contre les emprises diverses
Devenir soi c’est également la meilleure protection contre les différentes tentatives d’emprises, qu’elles soient interindividuelles, sociétales, mais aussi d’ordre politique, marketing, religieuse, etc.
Nous sommes témoins d’une époque où nous voyons des failles identitaires terribles et des vides de sens où s’immisce notamment, l’exemple peut-être le plus spectaculaire mais qui n’est pas le seul ; l’extrémisme dit religieux.
Sous couvert de l’idée de servir Dieu, des entrepreneurs politico-religieux se servent de l’idée Dieu, soit le substrat le plus fondamental qui soit pour un être humain à savoir le sens ultime des choses, pour un dessein politique qui vise à infliger le chaos pour prendre le pouvoir. Un but très terrestre.
La mécanique étant d’instrumentaliser justement le rapport au réel, dont le ressort principal consiste à affirmer dogmatiquement ce qu’est le réel. Si tous les « radicalisés » n’ont pas lu Kant, ils n’ont pas lu l’essentiel des théologies dont ils se réclament non plus.
On retrouve cette impossibilité d’accès au réel absolu, idée directrice de cet article, dans la théologie elle-même.
Le réel voilé dans les traditions monothéistes
Dans les traditions monothéistes, Dieu, l’Être absolu, Créateur, qui est vivant par Lui-Même, se révèle à l’être humain, mais ne s’expose jamais directement à lui, être créé, qui tire son existence de Lui. Et ce, même à celui que Dieu a choisi Lui-Même dans ce qu’on appelle la tradition prophétique.
Dans le livre de l’Exode, la sortie d’Égypte du peuple juif, deuxième livre du Pentateuque (le Pentateuque désigne les 5 livres dont l’ensemble constitue la Torah pour les juifs et l’Ancien Testament pour les chrétiens), au passage 33:18 Moïse demande à Dieu la possibilité de le voir
« Moïse dit : Fais-moi voir Ta gloire ! » […] en 33:20 « L’Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre ».
Dans le Coran, la même histoire est relatée dans la sourate 7 au verset 143.
« Et lorsque Moïse vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit : «O mon Seigneur, montre Toi à moi pour que je Te voie!» Il dit : «Tu ne Me verras pas; mais regarde le Mont: s’il tient en sa place, alors tu Me verras.» Mais lorsque son Seigneur Se manifesta au Mont, Il le pulvérisa, et Moïse s’effondra foudroyé. Lorsqu’il se fut remis, il dit : « Gloire à Toi ! À Toi je me repens ; et je suis le premier de ceux qui se placent sous Ta sauvegarde »
La montagne, symbole par excellence de l’assise, de la stabilité, de la constance et de l’ancrage est, exposée à la vision du Réel divin, pulvérisée. Moïse en est foudroyé alors même qu’il n’y est pas exposé directement. Que reste-t-il de spécifique à la créature devant le Créateur ?
L’accès au réel total est impossible, et le sommet que l’être humain peut en atteindre signifie l’effacement de ce dernier… La libération ultime. On entre dans l’ineffable de la mystique.
Pour revenir au terrain plus spécifiquement psychique, le travail sur soi permet une structuration interne solide et par là même une dimension identitaire pacifiée, ce qui est la meilleure protection face aux pervers de l’esprit qui extrémisent des identités en quête de sens.
Et qui n’est pas en quête de sens ? C’est pourquoi les profils des extrémistes sont très variés. Du profil psychopathique déjà criminel, aux « surdiplômés » qui a tout appris sauf l’essentiel, c’est à dire un savoir superficiel, non intégré, dont la quantité ne palliera jamais la déficience.
Une illusion prise pour la réalité peut entraîner un engagement mortifère. Qui plus est dans une époque d’hyper-modernité caractérisée par un manque de référence au passée et une absence de projection dans l’avenir. Période que Lipovestky a qualifiée d’ère du vide. Nous vivons une sorte de présent total, un court-termisme extrême, qui nous immerge dans des illusions qui peuvent nous être fatales.
Pour qu’un raisonnement soit fertile en termes d’actes profitables pour soi et les autres il ne doit pas simplement être cohérent sur le plan intellectuel. La cohérence intellectuelle dans un système de croyance délétères peut produire le pire, comme des génocides. Ainsi, en plus de la cohérence un raisonnement doit être enraciné. Sans enracinement le raisonnement peut produire un discours délirant tout en obéissant aux règles de la logique de son système de croyance. C’est pourquoi on peut voir des érudits raconter n’importe quoi. C’est ce explique aussi nos réflexes de préjugés : ce qu’on appelle le bon sens est parfois la pire forme de pensée. Non pas qu’un certain bon sens n’existe pas évidemment, mais parfois la pensée qui apparaît comme de bon sens aux premières égards se révèle être une absurdité totale une fois confrontée aux faits.
Mais qu’elle est donc la nature de cet enracinement qui permet de limiter ces égarements de la rationalité en roue libre ?
Le principe est simple, toute pensée doit d’abord passer par l’expérience de soi. Il faut, autant que faire se peut, penser les situations en y étant partie prenante et ne pas se dire que ça ne concerne que l’autre, sous entend par là qu’il serait différent de nature. Penser les choses dans la séparation « soi et les autres », c’est appliquer à autrui des analyses qu’on s’épargne sur soi. C’est l’éternelle histoire de la paille et de la poutre pour reprendre la formule de Jung.
Alors pourquoi c’est quelque chose de si difficile à faire ? Pas besoin d’avoir vécu bien vieux pour constater que nous sommes entourés de préjugés, de jugements violents, hâtifs et qu’on est soi-même capable de ça.
La difficulté vient du fait que précisément, ne pas laisser l’intellect dans son abstraction première et le faire passer au tamis de Soi, c’est se confronter à soi. C’est la chose la plus déstabilisante qui puisse exister. C’est le savoir vécu et pas simple « logiquement su ». Connaître les choses de manière purement logique est au fond superficiel. Ça n’engage à pas grand-chose. Vivre les choses en est une autre.
L’être humain est à l’origine un être à la fois inconscient et pétri d’illusion. Si l’on ajoute à ça, sa potentialité à faire du mal alors on ne peut que considérer qu’il représente le pire danger qui soit. Il n’y a pas de menaces plus grandes. Seulement toute sa dignité réside justement dans la capacité à se conscientiser, à explorer et s’explorer, à essayer de toucher le réel aussi difficile soit la démarche. Et ceci est impossible sans confrontation à soi. Et cette confrontation à soi est impossible sans l’altérité.
Si l’altérité est un risque, elle est la seule porte de libération. C’est le plus court chemin de soi à soi pour reprendre Ricoeur. Et c’est l’autre qui, pendant qu’on se confronte à soi, nous permet de tenir. Finalement le thérapeute ça n’est rien d’autre que ce plus court chemin de soi à soi. Et ça rencontre peut-être aussi inattendue que la vie est capable de surprise.
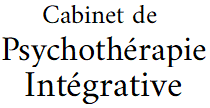



2 Commentaires
C’est un article remarquable. 👌🏽 cela met des mots sur tout ce qui se passe en moi, que je ressens, que je ne comprends pas mais qui est extrêmement dangereux inconsciemment. En fait nous avons tous le même potentiel que tous ceux qu’on considère comme des légendes. La seule différence c’est qu’ils ont reconnu et pris ce super pouvoir qui est en eux.
Génial , j ai eu mes réponses….MERCI.
Écrire un commentaire